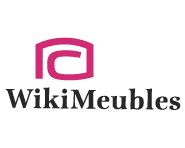Le boudoir… Voilà un mot joliment enfantin apparemment décoré d’un brin de naïveté. Mais qu’est-ce que le boudoir ? Un lieu où l’on se retrouve pour bouder ensemble ? Une pièce où l’on se retire seul quand l’envie de bouder devient trop forte ? Bien sûr, l’explication n’est pas aussi simple… Découvrez ici l’histoire du salon boudoir.

Sommaire
Le boudoir : quelle définition ?
Il se pourrait que le terme « boudoir » vienne de l’ancien français « boude » qui voulait dire ventre et qui ferait du « boudoir » un espace chaleureux comme un cocon dans lequel on se sent bien. Le boudoir apparaît donc sur les plans des architectes au milieu du XVIIIème siècle, au moment même où les pièces des palais et des appartement aristocratiques gagnent un usage spécifique. Souvenez-vous que les chambres à coucher comme celles du roi ou de la reine, n’étaient pas, loin s’en faut, les espaces intimes qu’elles sont de nos jours. Aussi fallut-il imaginer une nouvelle pièce où le propriétaire des lieux pouvait se retirer tranquillement sans se soucier du regard d’autrui.
Il se trouve que le boudoir a fait l’objet d’une étude approfondie d’une archiviste paléographe formée à l’École des Chartes, qui lui consacré sa thèse. Joséphine Grimm nous apprend donc que le mot « boudoir » est défini pour la première fois dans le Dictionnaire de l’Académie française en 1740 comme « un petit cabinet où l’on se retire quand on veut être seul ». Chaque maître ou maîtresse des lieux l’aménagera à sa guise, en fonction de ses goûts et de ses envies, en fera un lieu tout à fait privé ou destiné à recevoir quelques invités. Au XIXème siècle, le boudoir est vu comme une pièce presque exclusivement féminine.
Un boudoir, lieu frontalier
Le boudoir a ceci de particulier qu’il peut servir à plusieurs usages, à la frontière entre les espaces privés et les lieux qui peuvent accueillir des personnes étrangères à la maisonnée. Il peut être ainsi un espace intime réservé à des occupations personnelles comme le repos, la lecture ou l’écriture comme être un espace cosy pour la conversation.
Son emplacement dans les appartements est à ce titre intéressante car, s’il est d’abord placé tout près des espaces de nuit, de la bibliothèque… il se rapproche ensuite des pièces de réception.
L’histoire du salon boudoir : Un espace évolutif
S’il y a bien un point commun entre tous les boudoirs, c’est cette niche qui permet d’accueillir une ottomane ou un sofa pour se reposer pendant la journée. Et pourquoi pas la nuit me direz-vous ? Car l’ottomane est dépourvue de baldaquins destinés au repos nocturne. Aussi, dans la première moitié du XVIIIème siècle, le boudoir semble plutôt dévolu au repos avant de devenir un lieu réservé aux dames. Dans les fantasmes et dans la littérature, le boudoir devient un espace érotique. Il suffit alors d’écrire le mot « boudoir » pour suggérer ce qu’il s’y passe.

Boudoir : une décoration soignée
Souvent, les boudoirs possèdent des plafonds peints, des miroirs qui sont encore des objets onéreux, des bois exotiques… témoignant du soin apporté à cette pièce pourtant relativement réduite. Si le lit est un meuble presque obligé dans le boudoir, le reste de la décoration varie selon les propriétaires des lieux qui le décore en fonction de ses goûts personnels. Le boudoir est en quelque sorte l’expression la plus intime des goûts et des couleurs de celui qui l’occupe.
Les boudoirs de Marie-Antoinette
Pour échapper à la lourde l’étiquette de la cour, Marie-Antoinette s’échappe souvent au Petit Trianon qui est son havre de paix. Mais il est un autre lieu qui offre au couple royal des moments plus paisibles qu’à Versailles : le château de Fontainebleau. Et à l’intérieur de celui-ci, se trouvent deux boudoirs célèbres, conçus à 10 ans d’intervalle, très appréciés de la reine.
Le boudoir turc : l’inspiration Ottomane
Le premier, le boudoir turc, est décoré d’arabesques, de turbans, de brûle-parfums sculptés et de lambris aux couleurs exotiques qui donnent à cette pièce un parfum oriental qui fait tout son charme. La reine y reçoit ses dames de compagnie et y change de toilette avant de rejoindre les appartements d’apparat. L’alcôve, recouverte de miroirs des murs au plafond, est meublée d’une luxueuse ottomane.
Et puis ce boudoir renferme un grand secret ! Marie-Antoinette a commandé à son ingénieur Jean-Tobie Mercklein, un système de poulies et de contrepoids qui permet d’occulter la fenêtre en pressant simplement un bouton. Comble du luxe, ce mécanisme a en plus l’avantage de protéger du froid et de calfeutrer les sons…

Le boudoir d’argent : la nature au cœur de la pièce
Le boudoir d’argent quant à lui, se trouve au premier étage. Marie-Antoinette s’est inspirée de son amour de la nature pour commander des motifs floraux qui, soit dit en passant, sont tout à fait récurrents sous son règne. Les peintures des panneaux muraux, signées Pierre Rousseau, ressemblent à des fresques antiques. Grâce à l’application de feuilles d’or blanc, ceux-ci ont un éclat nacré, comme celui des tissus des sièges qui valent à cette pièce le nom de « boudoir d’argent ». Pour le meubler, Marie-Antoinette a fait appel à son maître ébéniste préféré, Jean-Henri Riesener, qui a créé pour elle un secrétaire à cylindre et une table à ouvrage en nacre uniques en leur genre.
Jean-Henri Riesener (1736/1804) se fait connaître en terminant le célèbre bureau à cylindre commandé par Louis XV à son beau-père, le maître ébéniste Jean-François Oeben. Doté d’un mécanisme très ingénieux, ce bureau révèle des tiroirs secrets d’un simple tour de clé. Devenu la coqueluche de la cour, il crée notamment pour Marie-Antoinette, ses meubles les plus novateurs.
Quoi qu’il s’y soit réellement passé, le boudoir, expression intime dans un lieu qui ne l’est pas vraiment, porte en lui une part de fantasme. Il en va de ces espaces dont la destination n’a pas été clairement définie, ouvrant ainsi une porte vers le désir d’inconnu.

Le style boudoir, aujourd’hui
Le salon boudoir fait aujourd’hui encore parler. On s’inspire de ses codes et on les remanie, surtout dans des espaces de bien-être destinés aux femmes, à l’instar des centres d’esthétiques. Les chaises médaillons, la couleur rose, les couleurs pâles, ou encore les fleurs sont très utilisées pour créer cet effet boudoir des temps modernes.

Mais le style boudoir est également un milieu qui fascine, qui est attirant. C’est pour cela que les codes du boudoir sont souvent repris dans des shooting photos, par des marques de lingerie. La créatrice de pièces de sous-vêtements féminins Chantal Thomass reprend d’ailleurs tout à fait les codes d’un salon boudoir dans ses boutiques et dans ses créations. Dans les cabarets également, le style boudoir est également très souvent réinterprété.